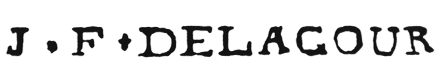Reçu maître le 17 février 1749, il exerça rue du Faubourg-Saint-Antoine en face de la rue Saint-Nicolas
Il devint juré de sa corporation en 1756 et maître de la confrérie de Sainte-Anne des maîtres menuisiers de la ville de Paris au couvent des Carmes Billettes.
son estampille
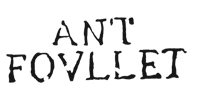
Il épouse vers 1730 Geneviève Bailleul dont il eut pour enfants :
- Marie Geneviève mariée à Antoine-François Beckers, horloger, puis André César Vallée, fondeur et Jacques-Antoine Gelé, fourbisseur,
- Pierre-Antoine, maitre ébéniste,
- Antoine André, maître horloger.
Il travaillait spécialement pour les horlogers, produisant des boîtiers de pendule, cartels et gaines de régulateurs en marqueterie de bois des Indes, qu'il orna de bronzes fondus chez Héban, rue des Arcis.
Il travailla également la marqueterie dite Boulle, le vernis martin et la laque.
A partir de 1752 il collabore avec Jean-Joseph de Saint-Germain, fondeur parisien très réputé dans la réalisation de caisses de pendules dont il semble avoir donné les dessins.
On retrouve sur ces caisses d’ébénisterie les mouvements de nombreux horlogers parisiens dont Philippe Barat, Cormaison, Fillon, Panier, Richard, Viger, ou de province comme Burgeat, Caron et Caranda à Versailles, Michel à Dijon, Musson à Orléans, Johann Jakob Straubhaar à Strasbourg...
Ayant également travaillé avec des horlogers du roi tels Julien Le Roy ou Jean-André Lepaute, il n'est pas impossible qu'il leur ait fourni des caisses d’ébénisterie livrées ensuite à la cour de France sous Louis XV.
Cependant Antoine Foullet ne semble pas s’être limité à ce genre de production. En effet, le musée de Stockholm conserve une commode de style Transition portant son estampille ainsi que celle du marchand-ébéniste Léonard Boudin.

A sa mort survenue le 24 septembre 1775, il laissait en cours d’exécution une douzaine de boîtes de pendule dont la prisée fut faite par ses confrères Lieutaud et Duhamel, réputés tous deux pour le même genre d’ouvrages.
Sources et bibliographie :
Le Mobilier Français du XVIIIème Siècle - Pierre Kjellberg - Les Editions de l'Amateur - 2002
Les ébénistes du XVIIIe siècle - Comte François de Salverte - Les éditions d'Art et d'Histoire - 1934