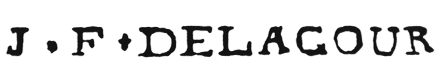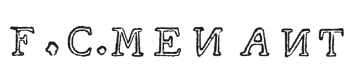Pierre Millot serait né vers 1719.
En 1742, il travaillait à Paris comme compagnon puis il fut reçu maître horloger le 1er août 1754 par décret du 25 juin de la même année.
Il s'installa rue Saint-Dominique près la rue du Bac, paroisse de Saint-Sulpice à Paris.
En 1754, il épousa Thérèse Émilie Lefebre, dont il eut Jean-Pierre-Nicolas (maître-horloger en 1785) et Thérèse-Émilie, qui épousera
Nicolas Thomas (mort après 1806), nommé horloger du Roi en 1778.
En 1777, il donnait en bail à
Jean-Baptiste Duluc, maître horloger au service du comte d'Artois, demeurant rue Taranne, paroisse Saint-Sulpice, sa boutique sise rue du Bac, au coin de la rue Saint-Dominique, moyennant 900 livres par an
Sa réussite lui valut une belle aisance financière, au point qu'il devint propriétaire d'une maison de campagne à Issy où il se rendait l'été.
Il continua à travailler jusqu'à sa retraite à Sens en 1785 ou il œuvra à la création d'une nouvelle horloge pour la ville.
Il vivait encore en 1794. En octobre de cette année (28 vendémiaire, an III), le citoyen Pierre Millot, ancien horloger, à Paris, demandait la continuation de sa pension de 300 livres accordée par Louis XV en 1763 pour l'invention et l’exécution d'une pendule placée au château de la Muette - une demande qui lui fut refusée.
Pour la production de ces pendules, il a collaboré avec le sculpteur René Michel dit Michel-Ange Slodtz (1705-1764) à la conception de différents modèles de caisses d'horlogerie.
Il a été fourni par le fondeur-ciseleur Robert Osmond (1711-1789, maître en 1746).
En 1762, Pierre Millot avait présenté deux de ses nouvelles horloges à demi-secondes à l'Académie des Sciences dont une astronomique.
La même année, il fournissait au Menus-Plaisirs pour 4000 livres la pendule du grand salon du château de la Muette.
Cette pendule astronomique, qui indiquait tous les mouvements célestes, diurnes & nocturnes, avait été présentée au Roi.
Cette livraison lui valut son titre d'horloger du roi et une pension royale de 300 livres.
En 1772, il créa une autre horloge innovante à calendrier, sonnant les demi-secondes aux heures et aux demi-heures, avec indications de l'année, du mois, des jours de la semaine et du lever et du coucher du soleil à Paris. Selon Tardy, ce calendrier comportait 9999 ans.
Jean Dominique Augarde, Historien d'Art, émet l'hypothèse que Millot serait aussi l'auteur « des pendules à équations, l'une solaire et l'autre lunaire, décorées de bronze ciselé et doré en bronze doré relatifs au soleil et à la lune, avec des attributs d'Apollon et Diane… » livrées en 1762 par Gilles Joubert dans la petite chambre de Louis XV à Versailles et dont
les caisses d’ébénisterie subsistent dans les collections royales anglaises.
L'inventaire de 1791 les décrits comme "Une pendule à seconde dans la boëte de marqueterie richement orné de bronze doré portée sur quatre pieds à griffes de lion et terminée par un vase à bouton de flamme de 7 pieds 2 pouces de haut. Une autre pendule à boussole; le cadran à 24 heures mêmes ornements et terminé par un vase à étoile".
La deuxième horloge aux attributs de Diane était une horloge planétaire selon le système de Ptolémée.
Pierre Millot bénéficia également du patronage de nombreuses autres personnalités de son époque dont M. Dejean, le marquis de Beringhem, le duc et de la duchesse de Chevreuse, le duc d'Aumont, dont la vente en 1782 comprenait une pendule de Millot, logée dans un boîtier plaqué orné de bronze doré, vendue 584 livres.

Exceptionnelle pendule astronomique signé de Millot
caisse en bronze doré attribué à Robert Osmond
Epoque Louis XV vers 1760
Sources :
Archives nationales, minutier central des notaires.
Journal des débats et décrets - 1794
Dictionnaire des Horlogers français, Tardy [Henri - Gustave Lengellé]
Les bronzes dorés français du 18e siècle, Pierre Verlet.
Les Ouvriers du Temps, Jean-Dominique Augarde